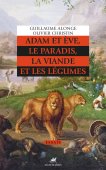Marcel Griaule, un ethnographe dans la diplomatie de l’entre-deux-guerres
Avec Yves Pourcher, qui a préparé l'édition chez Anacharsis des textes de Marcel Griaule sur la guerre d'Éthiopie en 1935-1936 : Envahir l'Éthiopie. L’ethnologue en guerre (1935-1936)
Pour cet épisode, nous sommes ravis d’accueillir Yves Pourcher pour parler de Marcel Griaule, un anthropologue, explorateur et écrivain au destin particulier notamment parce qu’il est entré dans la diplomatie lors de la crise d'Abyssinie.
Yves Pourcher, professeur de science politique, a rassemblé plus de 50 textes de Marcel Griaule dans une publication, parue en 2023, intitulée Envahir l’Ethiopie. L’ethnologue en guerre (1935-1936). Il détaille le parcours de vie original de Marcel Griaule et, en particulier, sa fonction de conseiller particulier d’Haïlé Sélassié pendant la guerre italo-éthiopienne qui l’a mené à participer à la rédaction du fameux discours prononcé par l’Empereur d’Ethiopie devant l’Assemblée de la Société des Nations, à Genève, le 30 juin 1936.
Un extrait sonore, avec la voix d’Haïlé Sélassié enregistré le jour du discours, est à écouter pendant l’épisode.
Yves Pourcher s’exprime également sur l’engagement des ethnologues qui sont confrontés à une guerre sur leur « terrain » d’étude.
Ressources
Livre : Envahir l’Ethiopie. L’ethnologue en guerre (1935-1936), éditions Anacharsis
Plus d'informations sur Yves Pourcher : https://lassp.sciencespo-toulouse.fr/Yves-POURCHER
Différend entre l’Ethiopie et l’Italie. Requête du gouvernement éthiopien (commentaires de M. Marcel Griaule) (14 septembre 1935) : https://archives.ungeneva.org/differend-entre-lethiopie-et-litalie-requete-du-gouvernement-ethiopien
Texte du discours d’Haïlé Sélassié devant l’Assemblée de la Société des Nations (30 juin 1936) en français et amharique : https://archives.ungeneva.org/ethiopia-speech-by-the-emperor-haile-selassie-to-the-league-assembly-2
Enregistrement sonore du discours d’Haïlé Sélassié devant l’Assemblée de la Société des Nations (30 juin 1936) : https://archives.ungeneva.org/haile-selassie-eth-whole-speech-in-amharic